 Un article intéressant dont la lecture mérite d'être partagée et explicitée.
Un article intéressant dont la lecture mérite d'être partagée et explicitée.
extrait de la revue OCL"Oléagineux, corps gras, lipides"
Titre intégral :Prévention de l’oxydation des acides gras
dans un produit cosmétique : mécanismes, conséquences, moyens de mesure, quels
antioxydants…
Cet article me semble d’une lecture un peu ardue pour les
esprits non scientifiques mais mérite un petit effort…Lien pour une lecture complète
Il s'agit d'un article de 2004 mais ce qu'il indique est
toujours valable...
J'ai relevé quelques points qui méritent qu'on les mette en
avant dans le cadre de nos tambouilles...
Déjà un rappel très simpliste : l'oxydation, c'est l'effet
de l'oxygène de l'air.
« Le phénomène d’oxydation des acides gras conduit à
une dégradation organoleptique de la matrice qui les contient, avec apparition
d’une flaveur caractéristique « rance » qui modifie la qualité
marchande du produit et conditionne directement sa durée de vie. »

2 types de facteurs influent sur l'oxydation.
- Exogènes (« externes ») : "la température et
la lumière apportent l’énergie facilitant le passage à l’étape radicalaire.
L’aération assure quant à elle le renouvellement du réactif (oxygène) et décale
ainsi la réaction vers la formation des produits oxydés"
L'aération, c'est l'ouverture du pot ou de la bouteille, et
l’air qui reste piégé à l’intérieur...
- Endogènes ("internes") : la nature du corps gras
"le taux d’insaturation, les traces de
photosensibilisateurs, l’absence d’antioxydants naturels, sont corrélés à une
augmentation du risque oxydatif. La qualité du corps gras est également garante
de la maîtrise du risque oxydatif : ainsi la sélection d’un corps gras dépourvu
de peroxydes (indice de peroxyde faible), dépourvu d’acides gras libres
(acidité oléique faible), ne comportant pas de traces de métaux pro-oxydants,
contribuera à améliorer la stabilité à l’oxydation de la formule"
L'effet de certains composants de la crème sur l'oxydation
par la lumière :
"Oxydation photosensiblisée : grâce à la présence
nécessaire d’un agent photosensiblisateur (pigments type chlorophylle, certains
colorants, certaines vitamines), l’oxygène de l’air est activé, passant de son
état fondamental dit « triplet » à un état excité dit « singulet », état dans
lequel l’oxygène a suffisamment d’énergie pour se fixer directement sur l’acide
gras (par un mécanisme dit de « ène addition »), sans passer par l’étape
radicalaire. Les mécanismes réactionnels sont donc différents, les produits
formés sont différents."
"En effet, les constituants suivants d’une formule sont
susceptibles d’interagir avec le corps gras et d’influencer le déroulement des
réactions d’oxydation :
* – eau : en
présence d’eau, les risques d’hydrolyse augmentent ; or, plusieurs études font
état de l’oxydabilité supérieure des acides gras lorsqu’ils sont à l’état libre
;
* – traces de
métaux pro-oxydants (fer et cuivre sous forme libre) : ils augmentent les
cinétiques de formation des radicaux et de décomposition des hydroperoxydes
pour des teneurs faibles (centaines de ppb) ;
* – protéines,
peptides, acides aminés : de manière générale, il est noté un rôle favorable
des fonctions amines sur la stabilité oxydative des huiles végétales ;
* – émulsifiants
: placés aux interfaces, ils sont souvent associés à une limitation de la
diffusion de l’oxygène entre les phases aqueuses et huileuses des
émulsions."
Je pense pouvoir traduire en schématisant par : l'eau augmente le risque
d'oxydation, les métaux pro-oxydants aussi, les protides le diminuent, les
émulsifiants le diminue.
Il y a deux sortes d'anti-oxydants, les primaires et les
secondaires.
Les primaires qui s'oxydent à la place des acides gras mais,
contrairement à eux, se stabilisent sans évoluer vers la phase radicalaire (les
composés pas glop).
Les secondaires ont plusieurs modes d'action :
- soit ils prolongent la durée de vie des primaires
- soit ils piègent les métaux pro-oxydants
- soit ils piègent l'oxygène
Parmi les anti-oxydant primaires on trouve des anti-oxydants
naturels.
"Cette catégorie comprend également les antioxydants
naturels, parmi lesquels les tocophérols (E306 à E309) sont les plus connus, et
très couramment utilisés du fait de leur liposolubilité, de leur synergie avec
d’autres molécules antioxydantes et de la possibilité de les utiliser « quatum
satis ». En matière d’antioxydation, les formes γ et δ tocophérols offrent la
meilleure efficacité, suivie par les formes α et β tocophérols. L’α tocophérol
est la forme d’apport vitaminique (vitamine E) privilégiée : dans ce cas,
l’apport peut se faire sous forme libre ou estérifiée. Par contre, lorsque
c’est l’effet antioxydant qui est recherché, les tocophérols doivent être
impérativement formulés sous forme libre, de telle sorte que la fonction
hydroxy ne soit pas engagée dans une liaison ester.
Parmi les antioxydants naturels, le marché propose de
nombreux extraits végétaux riches en molécules phénoliques ayant une activité
de rupture de chaîne (extraits de romarin, extraits de thé vert, extraits de
raisin…) dont le statut réglementaire n’est pas clarifié à ce jour en France."
Je relève une donnée importante : la vitamine E utilisée
pour la'pport vitaminique comporte des tocophérols sous une forme qui n'est pas
adaptée pour le rôle anti-oxydant. J'en déduis donc qu'il vaut mieux utiliser
pour nos tambouilles de la vitamine E spécifique vendue à usage cosmétique et
non des gélules destinées à être des compléments alimentaires.
Je note aussi qu’en France, le statut réglementaire d’autres
anti-oxydants naturels est dans le flou…
Parmi les anti-oxydants secondaires, je relève des pistes
intéressantes :
« Les antioxydants secondaires synergistes, prolongeant
la durée de vie des antioxydants primaires : c’est le cas de l’acide
ascorbique, hydrosoluble, et de son homologue plus liposoluble (jusqu’à 250-300
ppm), le palmitate d’ascorbyle. »
«Les antioxydants secondaires chélateurs de métaux, piégeant
les métaux prooxydants (fer et cuivre) : c’est le cas de l’acide citrique
ou des lécithines, qui présentent une efficacité pour des doses d’incorporation
faibles (à partir de 50 ppm) »
« Signalons
également l’effet antioxydant très intéressant des phospholipides (lécithines)
utilisés en synergies avec les tocophérols naturellement présents dans les
huiles végétales, bien connu empiriquement depuis de nombreuses années, et
démontré par des données objectivées dans une étude récente »
Donc, dans nos tambouilles, on pourrait penser que vitamineE
plus lécithine, c’est mieux que vitamine E…Et moi qui n’apprécie pas la lécithine
comme émulsifiant…Voilà peut-être de quoi m’inciter à l’employer…

La revue OCl est une édition John Libbey Eurotext, vous pouvez vous inscrire à sa news letter et consulter le sommaire des numéros et des articles sur leur site. Un certain nombre d'articles, comme celui-ci, est en accès gratuit complet.
Bonne lecture !



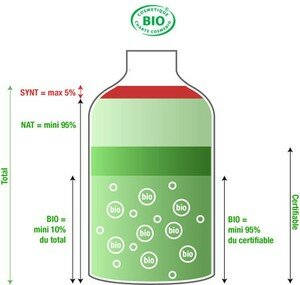



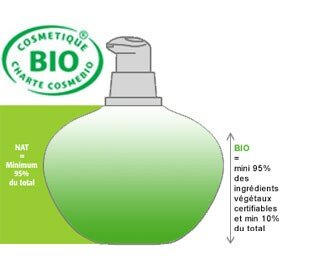
 Le label ECO de la
Charte Cosmébio
Le label ECO de la
Charte Cosmébio








 Il ne semble pas exister actuellement de calculateur en français, gratuit, utilisable hors ligne par les savonnières.
Il ne semble pas exister actuellement de calculateur en français, gratuit, utilisable hors ligne par les savonnières. Un article intéressant dont la lecture mérite d'être partagée et explicitée.
Un article intéressant dont la lecture mérite d'être partagée et explicitée.




/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F3%2F7%2F37183.jpg)
/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44309%2F3780622_o.)